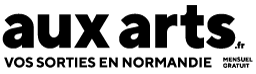Le cinéma, art du mouvement (kinêma = mouvement en grec) a très vite épousé le corps comme étalon de son évolution esthétique. Niché dans un anthropocentrisme de bon aloi qui mettra en jeu de façon permanente le corps dans un cadre, le cinéma tentera vainement de contenir un corps qui n’aura que faire des limites de sa représentation et qui ne cessera de les déborder. Le cinéma court après le corps et c’est lui, cet ennemi intime, qui l’accompagne dans ses mutations esthétiques.
Nous sommes en 1882. Étienne-Jules Marey est membre émérite de l’Académie des sciences et physiologiste déjà reconnu pour un écrit majeur au titre prémonitoire : « La machine animale » écrit en 1874. Avec ses assistants, il s’enferme dans la station physiologique qu’il vient de créer avec le soutien du ministère de la Guerre : dans une ambiance délétère, les quelques généraux défaitistes qui l’habitent encore s’intéressent de très près à la « méthode de marche » de l’armée allemande, vainqueur de la guerre de 1870.
Étienne Jules-Marey développe la photochronographie qui deviendra la chronophotographie en 1888, une technique permettant d’imprimer la déconstruction d’un mouvement sur une plaque de verre puis sur un support souple. Athlètes et circassiens défilent devant son fusil photographique : Étienne-Jules Marey invente le corps sportif et l’inscrit dans les fondations même du cinéma. (Visuel d’illustration ci-dessus : photogramme du film chronophotographique « Saut périlleux » (1897) – Étienne-Jules Marey et Georges Demeny, © Cinémathèque française 2023).
La pratique sportive devient très rapidement un territoire d’exploration pour le cinéma burlesque dans les années 20. Charlie Chaplin (Charlot boxeur, 1915 puis Les lumières de la ville, 1931), Harold Lloyd (Vive le sport, 1925) et Buster Keaton (Le dernier round et Sportif par amour, 1926) s’emparent des stades et des rings pour explorer la relation du corps à la pratique sportive et développer les mécanismes du gag burlesque. Le corps indocile fait alors œuvre de résistance, tente de plier puis de détourner la pratique dans un registre souvent catastrophiste et finalement humaniste : rarement les perdants n’ont été aussi radieux et réjouissants, opposant leur indolence et leur ingéniosité à la rigidité massive et régulée du corps sportif.
En France, le sport est collectif voir collectiviste sous l’égide du Front Populaire et irrigue le cinéma populaire – On tape régulièrement la balle dans la filmographie de Julien Duvivier et Marcel Carné – mais c’est l’avant-garde française qui va influencer deux œuvres majeures qui, sous couvert de dérèglement de la pratique, dénicheront un corps poétique sous le corps sportif. Réalisé en 1928 par André Hugon, La grande passion propose des vues inédites, « du dessous », d’un match de football réalisées sur une plaque transparente mais échoue à saisir la dynamique d’une course, condamnant ses footballeurs volants à un étrange « sur place ». En 1931, Jean Vigo expérimente de multiples techniques en filmant le champion Jean Taris dans Taris, roi de l’eau : la performance est totalement soumise aux caprices d’un cinéma qui accompagne un corps sous-marin et gracieux semblant défier l’attraction universelle.

Le sport n’échappera pas aux sombre années 30. L’Allemagne nazie décroche in extremis l’organisation des jeux olympiques de Berlin de 1936 et le führer s’entiche d’une jeune réalisatrice qui va amener l’imagerie sportive jusqu’à son point aveugle : Leni Riefensthal. La technique est prodigieuse et novatrice : les régimes totalitaires ont toujours apprécié la puissance de l’image pour asseoir leurs idéologies. Les moyens sont à la hauteur, promesse de « jamais vu ». Œuvres essentielles dans ce qu’elles peuvent avoir de plus révoltant, le diptyque Olympia – Les dieux du stade et Olympia – Jeunesse olympique vont définir pendant longtemps une forme archétypale dont l’héritière sera la télévision. Précision du cadre, jeux sur le ralenti : tout est réuni pour transformer les corps en arme d’idéologie massive. Ils flottent et volent, défiant méthodiquement les lois naturelles. Les corps deviennent ceux de dieux qui se défient dans l’arène, récupérant aux passages les images mythologiques de ces pauvres grecs qui n’ont rien demandé. Le surhomme est naissant, terreau fertile d’une idéologie crasse dont les images resteront un canon télévisuel florissant encore aujourd’hui. Les termes seuls ont changés : plus de surhomme, juste des « stars ».
Difficile de se remettre d’une imagerie qui tente de faire « nation », globalisante et puissante jusqu’à son propre effondrement. Le salut, comme la victoire, viendra d’Outre-Atlantique. Aux États-Unis, le cinéma s’empare du sport comme expression individuelle et non nationale au nom d’une idéologie toute autre… Et installe durablement la boxe dans l’inconscient collectif américain. Réalisé en 1942 et inspiré de la vie du boxeur James J. Corbett, Gentleman Jim est un chef d’œuvre de Raoul Walsh habité par l’inoubliable Errol Flynn dans l’un de ses rôles les plus marquants. Les aventures malheureuses d’un sportif exceptionnel, Jim Thorpe, permettent à Burt Lancaster de démontrer ses talents de sportif et de circassien dans l’estimable Le chevalier du stade de Michael Curtiz réalisé en 1951. Deux films pour défendre le destin individuel, le dépassement de soi et la réussite sociale à travers le portrait de deux minorités, irlandaises et indiennes, dont la place doit être gagnée au nom du libéralisme étasunien… Même si celui-ci se dispense dans la sueur, les KO et les crochets du gauche.

Le libéralisme est-il une forme de violence ? Il laisse en tout cas pas mal de monde sur le carreau, perdants magnifiques du cinéma. La boxe s’impose rapidement comme l’expression la plus intense des maux du libéralisme, idéologie de la conquête et du combat permanent. Champion du monde des poids moyens de 1949 à 1951, réputé pour encaisser et rendre coups pour coups, Jake LaMotta reconfigure le portrait du sportif et inspire une série de films qui privilégient les bas-fonds au spectaculaire, travaillant au corps les athlètes dans des épreuves au dolorisme sanguin. Tandis que des gangsters règlent leurs comptes en s’adonnant à de fiévreux combats de lutte dans Les forbans de la nuit de Jules Dassin, la violence irrigue l’enfance de Jack LaMotta (Marqué par la haine, Robert Wise, 1951), se sublime sur le ring (Raging bull, Martin Scorsese, 1980) et stigmatise un corps esseulé et à jamais déformé. Chef d’œuvre du genre dont le récit épouse un match de boxe en temps réel, Nous avons gagné ce soir (Robert Wise, 1949) est une terrassante entreprise de démembrement du corps de Robert Ryan, carcasse exsangue et tuméfiée.
Les années 60 et 70 s’emparent du sport comme outil de critique sociale, recyclant la figure du gladiateur dans des joutes futuristes (Rollerball, Norman Jewison, 1975), transformant la nage en parcours introspectif devenu critique acérée de la petite bourgeoisie (The swimmer, Franck Perry, 1968) et transformant la soif de victoire en sociopathie arrogante (Downhill racer, Michael Ritchie, 1969). Le Nouvel Hollywood impose désormais les marginaux et les doux rêveurs. Les sportifs deviennent des doux dingues à la myopie sévère mais frappent juste et fort pendant leur match de hockey sur glace (La castagne, George Roy Hill, 1977), les prisonniers de guerre pratiquent le football en tapant la balle avec « L’O Rei » Pelé et mettent à l’amende les ambition nazis (À nous la victoire ! John Huston, 1981). Une nouvelle victoire pour le footballeur légendaire qui s’imposait déjà comme l’un des premiers représentants de la communauté noire à faire la couverture de Life.

Une vivacité rapidement remise au placard par le reaganisme qui va plier le corps sportif à ses injonctions conquérantes. Le culturisme fait son apparition, l’effort sportif devient effort de guerre, on troque le stade contre la jungle et autres terres inhospitalières. La pratique sportive se déplace alors dans un champ imaginaire en de multiples variations ubuesques : les parties de tennis se jouent désormais au ralenti avec des balles volantes (Les sorcières d’Eastwick, George Miller, 1985) ou avec un corps mutant (Les aventures d’un homme invisible, John Carpenter 1992) sans oublier des parties de basket à la précision millimétrée (Alien la résurrection, Jean-Pierre Jeunet, 1997) et le football vécu comme un art martial délirant (Shaolin soccer, Stephen Chow, 2001). C’est d’ailleurs par le basket que le sport reviendra au cœur du cinéma sur fond de revendications sociales (Les Blancs ne savent pas sauter, Ron Shelton, 1992, Blue chips, William Fiedkin, 1994, He got game, Spike Lee, 1998) avant que le rugby ne l’accompagne sur ce chemin vertueux (Invictus, Clint Eastwood, 2010).

Le retour du biopic parachève momentanément ce retour du sport au cinéma sous l’égide d’expérimentation des formes (Ali, Michael Mann, 2001) et d’hybridation des images (The program, Stephen Frears, 2015) offrant aux corps sportifs un nouvel élan esthétique écrit à partir de leur mouvement.
Cet article renvoie au dossier Sport & culture en Normandie paru dans Aux Arts#262, N° de janvier/février 2024.
Vous trouverez une filmographie sélective Sport et Cinéma en suivant ce lien : Live Creative – Sport & cinéma (Filmo)